26 juin 2007
2
26
/06
/juin
/2007
20:13
Trentenaire contre attaque
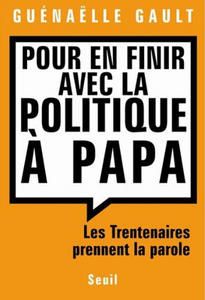
Depuis le 21 avril 2002 les trentenaires entretiennent avec la démocratie une relation pleine de désillusions. Alors quand ils entendent que l'élection présidentielle témoigne d’un regain de démocratie au vu des 86% de participation, leurs dents grincent. La politique n’a pas changé et ce n'est pas le niveau d'abstention aux dernières législatives qui viendra prouver le contraire. Guénaëlle Gault, trentenaire directrice d’études à la Sofres, nous explique pourquoi il est temps d'en finir avec "la politique à papa".

"l’augmentation de pouvoir individuel peut être convertie en puissance collective"
"les moyens comme des fins en devenir"
La "pacifique attitude" guide tellement ton livre que tu désamorces dès le prologue ta seule concession "marketing" à la provoc, qui réside dans le titre du livre. Tu dis que non, tu n’es pas là pour tuer le père…
Oui, il faut dépasser la politique à papa et ce n’est pas en tuant le père comme papa l’a fait en son temps qu’on y arrivera. Parce qu’on n’est pas dans la même époque, ni dans la même société ni face aux mêmes besoins, ce meurtre serait du gâchis.
Mais comment agir et peser politiquement si l’on reste en dehors du système ?
Je suis d’accord, il va falloir que des trentenaires rentrent dans ce système pour le changer, mais il y en a déjà quelques-uns. Mais surtout, je pense qu’il faut arrêter de pleurer sur les générations qui gardent tout. C’est vrai qu’il y a un petit problème de renouvellement dans les médias, en politique, etc. et il faut le dire, mais on a du pouvoir, vachement de pouvoir, plus que les générations d’avant. Par exemple, on parle sans arrêt de la révolution culturelle de mai 68, mais on ne parle presque jamais de la révolution culturelle majeure des années 80. Cette révolution, ce n’est pas nous qui l’avons faite – elle s’est faite un peu toute seule – mais elle a bien eu lieu. Il y a eu l’accélération d’un processus qui donnait beaucoup plus de pouvoir aux gens parce qu’ils étaient plus formés et qu’ils avaient un niveau de vie plus élevé. Les gens se sont progressivement émancipés de choses très pesantes jusque-là, qui étaient l’Eglise, la famille, les partis, etc. Et comme les individus ont plus de pouvoir sur eux-mêmes et plus de responsabilités, ils sont du coup plus prêts qu’avant à prendre ces responsabilités.
Dans ton livre, tu promeus d’ailleurs la responsabilité individuelle que pratiquent au quotidien les trentenaires…
Oui, il s’agit par là de huiler tous les rouages de cette société qui est beaucoup plus épaisse qu’avant. Ça ne veut pas dire qu’il ne faut pas des structures derrière pour relayer ces actions. Au contraire, il en faut car beaucoup de structures actuelles tombent en ruine. Mais je pense qu’il faut d’abord prendre conscience que cette augmentation de pouvoir individuel peut être convertie en une puissance collective. On ne décollera pas si on continue de culpabiliser parce qu’on se dit qu’on ne fait que des petites choses dans notre coin. Ce ne sont pas des petites choses futiles. C’est juste qu’aujourd’hui nous avons entériné toutes ces choses pour lesquelles nos aînés ont milité et qu’on les vit et les met en œuvre sans nous rendre compte qu’il s’agit de choses qui agissent sur le collectif et sur l’avenir.
 A ce propos, tu parles d’Internet, du fait que les trentenaires ont une intense vie sociale en se connectant sans cesse à différents réseaux. Mais avoir son Myspace ou consulter le Myspace de quelqu’un n’est-ce pas s’insérer dans un rapport instrumentalisé à l’autre, qu’on peut zapper à l’envie ?
A ce propos, tu parles d’Internet, du fait que les trentenaires ont une intense vie sociale en se connectant sans cesse à différents réseaux. Mais avoir son Myspace ou consulter le Myspace de quelqu’un n’est-ce pas s’insérer dans un rapport instrumentalisé à l’autre, qu’on peut zapper à l’envie ?
Avec cette révolution de l’individualisme, au lieu de partir d’un groupe qui te dit quoi penser, tu pars de l’individu. Mais ce n’est pas qu’une force centripète, c’est aussi une force centrifuge. Effectivement, il y a les dangers de l’égocentrisme, du repli sur soi, de la difficulté même d’être soi, mais je pense qu’on est en train de dépasser ça pour tendre vers quelque chose de plus centrifuge. Moi, je télécharge beaucoup de musique – politiquement c’est important pour que le système des maisons de disque change un jour –, mais aussi des séries, je lis beaucoup de blogs, etc. Je trouve qu’il y a une grande forme de générosité dans ces échanges.
A qui voulais-tu adresser ce livre, aux trentenaires ou aux générations précédentes ?
(Silence.) Je ne sais pas, c’était ma petite incertitude. Etrangement, ce sont plutôt des gens plus âgés qui ont réagi et c’était intéressant. Certains me disaient que j’étais désabusée alors je m’expliquais pour leur démonter l’inverse, d’autres qu’ils avaient juste vu les choses sous un nouvel angle et ça m’allait parce que c’est ce que je voulais faire avec ce livre.
A la fin du livre, tu adresses une dédicace à ton père : "A papa, sans rancune". Pourquoi ?
Mes parents sont dans l’enseignement, enfin ma mère y est toujours, et je pense que l’éducation nationale est encore un milieu particulier dans la société. Un milieu particulier aussi dans son approche des générations. Mes parents sont des parents contre lesquels je n’ai pas eu envie de me révolter politiquement. Je n’étais pas d’accord sur tout avec eux, mais politiquement, contrairement à beaucoup de gens de leur génération, ils n’étaient pas persuadés de détenir la vérité. Ils ont très tôt vu qu’ils devaient se remettre un peu en question sinon leur autorité prendrait l’eau de toute part. La dédicace est un peu un clin d’œil à ça !
Le livre s’ouvre sur un autre père, plus symbolique celui-là, puisqu’il s’agit de Mitterrand lorsque son visage apparaît à la téle le soir du 10 mai 1981. Ce livre c'est aussi : "A Mitterrand, sans rancune" ?
Mitterrand, c’est mon premier souvenir politique. Je me souviens que mes parents ne me disaient pas qu’ils avaient voté Mitterrand. Je me souviens aussi qu’un jour une enquêtrice de je ne sais pas quel institut – peut-être était-ce la Sofres ! – est venue demander à ma mère pour qui elle avait voté et ma mère avait été très gênée de devoir le dire devant moi. A l’époque le vote était tellement le seul moment politique dans la vie des gens qu’il était sacralisé et que c’était presque tabou d’en parler ! Il y a 25 ans, les gens disaient qu’ils n’y comprenaient rien à la politique, alors ils se contentaient de donner leur voix à quelqu’un, mais aujourd’hui, les gens s’emparent des sujets politiques, ils prétendent avoir un avis, ils en parlent entre eux. Ils sont beaucoup moins dans la délégation. Alors on peut parfois trouver que leur avis est merdique – et leur en vouloir pour le 21 avril 2002 –, mais c’est l’avis des gens et c’est respectable.
 Sur un autre plan, cela me rappelle l’émission de TF1, J’ai question à vous poser. J’ai vu le comportement du panel de Français présent quand Ségolène Royal y était invitée et on aurait dit des enfants. Chacun y allait de sa plainte, de son petit problème personnel…
Sur un autre plan, cela me rappelle l’émission de TF1, J’ai question à vous poser. J’ai vu le comportement du panel de Français présent quand Ségolène Royal y était invitée et on aurait dit des enfants. Chacun y allait de sa plainte, de son petit problème personnel…
La petite démocratie des "Moi je" n’a pas que des inconvénients. C’est normal que les gens partent d’eux et c’est normal de repartir des gens. Ils ont tellement l’impression, à juste titre, que les politiques ne comprennent rien à ce qu’ils vivent qu’à un moment donné ils ont besoin de passer par cette espèce de purge où ils vont leur dire tous leurs petits problèmes personnels. Mais derrière il faut que la démocratie se réconcilie avec une réelle participation, il ne faut pas que ce ne soit qu’une démocratie directe. Aujourd’hui, une chose est sûre : politiquement, il faut faire les choses de façon équilibrée. On le voit avec le progrès, par exemple. Avant on se fichait des moyens utilisés, on prétendait savoir où on allait, on allait là-bas, vers le progrès. Aujourd’hui qu’on sait que ça ne se passe plus comme ça, les moyens qu’on utilise prennent une importance cruciale. Il s’agit d’envisager les moyens comme des fins en devenir. Alors c’est sûr, c’est moins vendeur, mais c’est aussi moins manichéen, du coup ce qu’on perd en spectacle on le gagne en avancée concrète.
Ce livre aura-t-il une suite ?
Oui, il y a des choses sur lesquelles on ne s’arrête jamais de travailler et j’aimerais revenir sur le thème de l’émotion et de la sensibilité chez les vingtenaires. Je voudrais par exemple parler de leur l’humour – le malentendu serait de le prendre pour du cynisme, mais il est trash sans être cynique et donc très subversif – et de leur rapport à la musique. Tu es bien placé our voir que la musique a pris une ampleur formidable dans notre génération et de manière encore plus prégnante dans la génération d’après. Ce sont des choses qui changent beaucoup au niveau individuel mais du coup au niveau collectif aussi. Je pense que la place de l’émotion et la façon dont elle est instrumentalisée aujourd’hui est une clé pour demain.
Published by Sylvain Fesson
-
dans
IDEEcryptage
26 juin 2007
2
26
/06
/juin
/2007
11:43
Trentenaire contre attaque
 Depuis le 21 avril 2002 les trentenaires entretiennent avec la démocratie une relation pleine de désillusions. Alors quand ils entendent que les présidentielles de 2007 témoignent d’un regain de démocratie au vu des 86% de participation, leurs dents grincent. La politique n’a pas changé et ce n'est pas le niveau d'abstention aux dernières législatives qui viendra prouver le contraire. Guénaëlle Gault, directrice d’études à la Sofres, nous explique pourquoi il est temps d'en finir avec "la politique à papa".
Depuis le 21 avril 2002 les trentenaires entretiennent avec la démocratie une relation pleine de désillusions. Alors quand ils entendent que les présidentielles de 2007 témoignent d’un regain de démocratie au vu des 86% de participation, leurs dents grincent. La politique n’a pas changé et ce n'est pas le niveau d'abstention aux dernières législatives qui viendra prouver le contraire. Guénaëlle Gault, directrice d’études à la Sofres, nous explique pourquoi il est temps d'en finir avec "la politique à papa".

"Je veux être moins agressive avec nos aînés"
"J’adore l’aïkido car dans cette discipline il n’y a pas de perdants"
19 mars. 18h30. Près de République. La voilà qui arrive, dévale la rue Béranger, brushing au vent, iPod blanc dans les oreilles. Je l’attends au tournant. Pour parler de son livre, Pour en finir avec la politique à papa. Sous leur accrocheuse couverture orange Casimir, ces 150 pages écrites gros et sans style m’ont laissé sur ma faim. L’auteur y passe en effet plus de temps à résumer ce que tout trentenaire sait déjà, que le monde a changé depuis les années 50, que les grandes idéologies sont tombées, que les gens se sont émancipés, cultivés, responsabilisés, plutôt qu’à dire comment la politique doit changer et comment les trentenaires la changent déjà sans parfois même s’en rendre compte, par le biais d’Internet, des blogs, des flash mobs, du bio, du tri sélectif, de l’engagement associatif. Délaissant tout souci d’autocritique, son approche positive des trentenaires semble pêcher par excès de douceur. Dès le prologue, elle désavoue même le titre du livre, "exagérément provocateur car il ne s’agit pas de révolte" ni de "tuer le père". Mais paradoxalement c’est de cette fadeur que semble venir la force de son entreprise.
Guénaëlle arrive après la bataille, après celle des grands idéaux de 68, comme celle, éditoriale, qui a vu déferler ces dernières années tout un tas de livres consacrés aux trentenaires. Mais cela ne l’a dérange pas. Elle s’en réjouit presque. Parce qu’après la bataille, c’est encore la bataille. Celle-ci n’est finie qu’en apparence, dans le spectacle du défoulement démocratique qu’elle a copieusement laissé paraître le 6 mai 2007. Spectacle qui s’est vite révélé comme tel au vu de l’abstentionnisme record qu’ont suscité les élections législatives. Mais dans cette après guerre, il est encore temps, enfin temps, de s’atteler à la reconstruction d’une vraie politique. D’en poser les bases. Et c’est dans ce recul que ce livre prend tout son sens. Alors de notre côté, aussi, on se réjouit presque d’en parler alors que les urnes ont depuis longtemps tranché.
Ça fait six mois que le livre de Guénaëlle est sorti. Deux quand je la rencontre. Elle découvre les joies d’avoir un "filtre institutionnel" qui la relie aux médias : une attachée de presse  "marrante" car "un peu out" malgré son jeune âge. Durant ces deux mois le filtre a fait son job : Guénaêlle est passée à la télé sur Direct 8, Canal+, France 2, à la radio sur France Inter, Europe 2 et dans les journaux Toc et Psychologie Magazine. Elle a donc fait de la télé, de la presse et de la radio mais aucun des gros médias auxquels elle s’attendait. Mais elle n’est "pas mécontente" pour autant : son livre fait jaser la blogosphère et pour elle c’est presque préférable "que ça se passe ainsi, de manière un peu dérégulée" car d’un autre côté elle craignait de bénéficier d’un article dans un gros média qui l’aurait rendu fier mais "qui n’aurait pas fait bouger ni réfléchir." Elle a par contre vécu les inconvénients du gros média télévisuel en faisant l’émission Ce soir ou jamais de Frédéric Taddéï. Coincée entre "des pros de l’exercice télévisuel" tels que Raphaël Enthoven et Natacha Polony, avec lesquels elle était "en désaccord total sur le contenu", elle n’a pas pu s’exprimer. Ce qu’elle essaie de mieux faire le jour de notre rencontre, armée d’une bière pour saper la fatigue.
"marrante" car "un peu out" malgré son jeune âge. Durant ces deux mois le filtre a fait son job : Guénaêlle est passée à la télé sur Direct 8, Canal+, France 2, à la radio sur France Inter, Europe 2 et dans les journaux Toc et Psychologie Magazine. Elle a donc fait de la télé, de la presse et de la radio mais aucun des gros médias auxquels elle s’attendait. Mais elle n’est "pas mécontente" pour autant : son livre fait jaser la blogosphère et pour elle c’est presque préférable "que ça se passe ainsi, de manière un peu dérégulée" car d’un autre côté elle craignait de bénéficier d’un article dans un gros média qui l’aurait rendu fier mais "qui n’aurait pas fait bouger ni réfléchir." Elle a par contre vécu les inconvénients du gros média télévisuel en faisant l’émission Ce soir ou jamais de Frédéric Taddéï. Coincée entre "des pros de l’exercice télévisuel" tels que Raphaël Enthoven et Natacha Polony, avec lesquels elle était "en désaccord total sur le contenu", elle n’a pas pu s’exprimer. Ce qu’elle essaie de mieux faire le jour de notre rencontre, armée d’une bière pour saper la fatigue.
Guénaëlle, beaucoup de livres sont déjà sorti sur le thème des trentenaires. Pourquoi en rajouter un à cette longue liste ?
Moi, je voulais parler de cette génération pivot sous l’angle politique, lever tous les malentendus dont les trentenaires font l’objet, tout ces malentendus qui n’ont l’air de rien mais qui témoignent en réalité d’une mauvaise vision de la société, pour montrer qu’on doit enfin passer à une lecture positive de la société et donc à une autre forme de politique.
Qu’entends-tu par "mauvaise vision de la société" ?
Par exemple, tout ce discours décliniste selon lequel la France va mal et les français n’ont pas le moral. Tout ça n’a de sens que si on regarde la réalité de la société avec les lunettes du passé. Parce qu’alors on va forcément voir les choses qu’on perd au détriment des choses qui pourraient nous faire aller de l’avant. J’avais envie de parler des trentenaires parce que notre façon de faire de la politique diffère énormément de celle de nos aînés, qu’elle n’est pas reconnue et que c’est en la reconnaissant qu’on pourra construire une société efficacement. C’est mon point de vue. J’ai interrogé une vingtaine de personnes pour ce livre. Ça ne prétend pas être représentatif, ça prétend être significatif et donner matière à débat.
Aucun des livres déjà sortis sur les trentenaires ne te plaisait ?
Si, ceux du sociologue Louis Chauvel m’ont vraiment plu. Ce trentenaire est le premier à avoir très objectivement mis le doigt sur la croissance des inégalités intergénérationnelles depuis 1950. Il défonçait un peu la porte. Moi, j’arrive après et je veux être moins agressive à l’égard de nos aînés et moins culpabilisante à l’égard de ma génération. Moins réac aussi. J’ai trouvé le livre de Natacha Polony très réac (Nos enfants gâchés, Nda), ce n’est ma démarche et j’espère que ça se voit. Je ne dis pas qu’à certains moments l’agressivité ou la plainte ne sont pas utiles dans le débat, mais d’autres l’ont fait avant moi et ce n’est pas ma façon de faire. Je suis plus dans une espèce de discussion sans nombrilisme.
Tu es directrice d’études au département Stratégies d’opinion de TNS Sofres. J’imagine que ton travail est en étroite corrélation avec le propos de ce livre.
Bien sûr. Pour moi une façon de renouveler la politique consiste d’ailleurs à faire un véritable travail de décryptage de la société. Il faut voir et comprendre que les choses ne sont pas structurées comme avant. Comment le sont-elles ? Comment faire avec ? Ces questions ne sont pas un travail annexe, elles sont déjà politiques. Si la société ne sait pas se représenter elle-même, elle ne peut ni avoir de représentants ni définir le pouvoir à exercer. Tout ce travail un peu nouveau de décryptage est important, moi je peux le faire dans mon métier, toi tu peux le faire en tant que journaliste, et ainsi on peut créer le premier maillon d’une chaîne qui donnera une meilleure représentation de la société, à partir de laquelle on pourra enfin articuler un système politique représentatif.
Ta démarche n’étant ni agressive ni plaintive, le ton de ton livre s’en ressent, il est très doux et l’écriture très sujet-verbe-complément. Pourquoi ne pas y avoir mis un peu plus de panache ?
(Silence.) Je ne sais pas. Peut-être que je me plais à le croire, mais je trouve qu’il y a plus de provocation dans le fond que dans le ton et je pense que c’est comme ça qu’on communique le mieux aujourd’hui. Parce que la provocation de ton est partout et qu’il n’y a jamais rien derrière.
 Tu veux dire qu’on est dans un spectacle de la parole ?
Tu veux dire qu’on est dans un spectacle de la parole ?
Oui. D’un côté on souhaite du politiquement correct, du parler vrai, mais de l’autre on dit amen à tous les coups de gueule, à tel point qu’il faudrait presque ne plus s’exprimer que comme ça pour pouvoir avoir droit de cité dans les médias. Ceci est pervers et dessert, je pense, ce qu’il faut qu’on fasse en terme de politique. Certains disent que les jeunes générations sont très prudentes et très mesurées en politique. Dans la forme, oui, peut-être, mais dans le fond je ne pense pas. Aujourd’hui, ça ne sert plus à rien de casser ce qui a déjà été cassé, il s’agit plutôt d’être constructif dans la forme. Moi, cette façon de réagir me vient de la pratique de l’aïkido. J’adore cette discipline parce qu’elle symbolise aussi un moyen de communication équilibré. Dans l’aïkido il n’y a pas de perdants car on utilise notre force pour neutraliser la force de l’adversaire et on lui apprend donc quelque chose sur lui-même. Des gens savent très bien faire ça. Michel Serres, par exemple, est extrêmement efficace quand il discute avec quelqu’un car il arrive à lui donner raison sur certains points tout en faisant passer son message. Il y a beaucoup de respect et de courtoisie dans sa façon de faire.
Published by Sylvain Fesson
-
dans
IDEEcryptage
20 octobre 2006
5
20
/10
/octobre
/2006
00:58

"C’est le père ! me dit ma cervelle"
Je viens de voir La moustache, film d'Emmanuel Carrère sorti en 2004, et porté à l'écran par un joli duo d'acteur : Vincent Lindon (Marc) et Emmanuelle Devos (Agnès). Mais porté, le film l'est surtout par un livre : La moustache, roman du même Emmanuel Carrère (paru chez POL en 1986) et par ailleurs biographe de Philip K. Dick...
C’est quoi son trip de moustache à Marc ? Pendant que les images traversent nos yeux une partie de notre cerveau, Sherlock Holmes, continue à émettre des hypothèses en parallèle : cette moustache fantôme ne serait-elle pas une métaphore des zones d'ombres qu'on garde, volontairement ou pas, toujours nichées au fond de soi, invisibles aux yeux de son partenaire ? Ne serait-elle pas le symbole de ce bagage de vie qu’on ne peut pas partager, de ces recoins de l’âme qu’on n’a jamais cru bon de devoir présenter à l’autre ? Ne serait-elle pas ces atomes fondamentalement non crochus du bonhomme qui, rêvant de nous réinventer ailleurs, dans une autre vie, un autre monde, un autre corps, regardent toujours ailleurs au cas où, et feront toujours de nous des voyageurs semi clandestins, si vous voyez ce que je veux dire ? Cette moustache ne serait-elle pas la métaphore de ces zones troubles de l’individu (pleine de l’Autre) qui pourraient tout faire sauter si, d'un coup, on venait à les embrasser et en faire nos totems ; si d’un coup elles qu’on avait reléguées au sous-sol, elles se mettaient à jaillir puissamment du dedans et reconstruisaient totalement la géographie qui nous regarde et nous sous-tend.
On se dit que La moustache est un film sur le couple et l'impossibilité du couple. Un film sur l’impossibilité de connaître quelqu'un à fond. Un film sur la terra incognita capricieuse de la nature humaine. Un film psychanalytique. On se dit ça. On en est là. Jusqu'à ce qu'on apprenne que Marc a perdu son père et que ça ne date pas d’hier, genre ça fait un an. Et Marc l’apprend au même moment que nous, téléspectateurs, l’apprenons. C’est Agnès qui le lui rappelle alors qu’il pète les plombs rapport à sa moustache perdue et au fait qu’il ne sait plus où il en est, qui il est, etc. "Le père ?" C’est mon cerveau qui se réveille et lève son flaire pendant que les images continuent de traverser mes yeux et d’arriver quelque part. "Oui", je dis, sans savoir quelle part de moi prend la parole. "Mon cher, continue-t-il, nous tenons là quelque chose." Et vas-y qu’il me sert son discours sur la moustache rasée comme représentation du deuil impossible de la figure paternelle, comme geste auto mutilatoire cherchant à délivrer Marc de l’emprise du père sur lui et en lui ; de ce père disparu qui s’inscrit de telle manière sur son visage à lui, qui transparaît ici et là à chaque fois qu’il se regarde dans le miroir ; de ce père par rapport auquel il s’était forcément construit même s’il n’était peut-être pas souvent auprès de lui son père, de son vivant et blablabla. La tâche vertigineuse de faire face à ce que son père fut vraiment pour soi, maintenant qu’il n’est plus là, blablabla. De se sentir vide, nu, comme un enfant. Imberbe et orphelin. Et blablabla. Mon cerveau s’y croit. Il tient une piste. Sauf qu’à peine a-t-on le temps de se la formuler clairement que la piste du « film psy » se dérobe à nous.
"Continents à la dérive / qui m’aime me suive / gouffres avides / tendez moi la main (…) continents à la dérive / une vague idée me guide / c’est l’heure où je glisse / dans les interstices / à l’article de l’amour / je redeviendrais l’enfant terrible / que tu aimais (…) un jour j’irais vers une ombrelle / y seras-tu ?" Bashung toujours, dans "L’irréel" sur l’album L’imprudence.
Dans la dernière partie du film, il n’est plus question du père. Il est question de rien. Débarrassé de sa moustache, de son identité, de sa femme et de sa sexualité, Marc prend la tangente pour Hong Kong. Belle musique (de Philipp Glass), belles images (de mer, de végétation, de foule anonyme), débarrassé de toutes paroles (mais pas de tout propos), le film glisse et nous laisse en compagnie de nos pensées. C’est un des plus beaux passages du film. Là où le mal être culminant de Marc semble étrangement trouvé un soulagement, un répit. (On pense à Lost in Translation, à Vincent Lindon errant, étranger dans une ville étrangère, comme un Bill Muray que tout sens de l’autodérision aurait déserté.) Dans l’état transitoire de ces limbes retrouvés, anonyme parmi des anonymes, rouage parmi des rouages, Marc tente de se restructurer en effectuant chaque jour le même mécanisme, la même routine. Chaque matin, le même ticket demandé à la guichetière, glissé dans le même tourniquet et le même bateau qui le prend, à la même heure, à la même place, avec les mêmes gens dedans. Même chose le soir en sens inverse, répétée X fois. (On pense à L’adversaire, le précédent film d’Emmanuel Carrère. La routine y a la même place, primordiale et structurante. Un homme qui se fait passer pour médecin aux yeux de sa famille et de tout son entourage passe ses journées à zoner dans sa voiture au bord de la route. Cette routine de l’homme reclus, monstre en sa tanière, le fait tenir. Et je ne sais pas trop pourquoi mais la situation du personnage – sans doute parce qu’elle symbolise un sentiment d’isolement monstrueux qu’on porte tous en nous à des degrés divers – m’a procuré un fort sentiment d’identification lorsque j’ai vu le film.)
Comme tout foutait le camp dans sa vie d’avant, enfin sa vie d’avant après (car je vous le rappelle, pour lui il y a eu un avant – la moustache est là – et un après – moustache n’est plus là – dans sa vie d’avant), Marc cherche l’après de vie d’avant après. Un second souffle, quoi. Et il se dit que zoner parmi 700 millions de Chinois (et moi, et moi, et moi) ça va peut-être l'aider à y voir plus clair. Que dans cette routine où il se dé-foule il va finir par se trouver lui, refaire jaillir son identité. Mais ça ne semble pas marcher du tonnerre. Dans la chambre d’hôtel où il s’est arrêté pour la nuit, il sort du tiroir du bureau une carte postale vierge déposée là à l’attention des clients. Et sur cette carte postale qu'il projette d'envoyer à sa femme, du fond de sa solitude, il écrit : "J'aimerais que tu vois ce que je vois. Sans tes yeux, je ne vois rien."
Et le voilà qui se réveille, quelques jours plus tard, auprès d’elle. Comme de par magie. Louche cette Agnès qui refait irruption dans la réalité, dans sa réalité à lui, qui revient hanter positivement sa nouvelle vie. Agnès est là. Mais est-elle vraiment là ? A-t-elle toujours fait partie du voyage ou revient-t-elle seulement dans la tête de marc comme un ultime trip qu'il se fait pour boucler la boucle ? N’est-elle pas un dérapage de sa psyché agonisante ? Le signe de son affaissement final ? Parce que cette Agnès-ci n'a rien à voir avec l’Agnès de Paris. Elle est toute de tendresse et d’amour avec lui. Et quand elle arrive, l’exil de Marc à Hong Kong n’est plus un exil : cela devient d’un coup les vacances d’un couple amoureux. On découvre qu’ils ont même rencontré un autre couple là-bas et qu’ils ont sympathisé avec eux Mais dès que Marc montre qu’il n’est plus très chaud à l’idée de traîner en leur compagnie, Agnès va dans son sens en lui disant qu’ils peuvent effectivement cessé tout de suite de les fréquenter, que ce n’est pas grave, car ces gens ils ne les reverront plus une fois sur Paris. C’est donc le négatif d’Agnès auquel on a à faire. Une Agnès qui n’a plus peur de ne pas jouer la comédie et d’être politiquement incorrect. Mais une Agnès qui lui demande tout de même de bien vouloir raser cette affreuse barbe qu’il s’est laissé pousser pendant les vacances. Car la barbe c’est marrant le temps des vacances, mais à Paris ça fera mauvais genre. Il s'exécute, rase tout même la moustache. Et là, tout se passe à merveille, Agnès s’aperçoit bien qu’il vient de raser la barbe et la moustache. Ça y est, fini maman ! Elle le reconnaît. Ils s'entendent. Mais ça n'apaise pas Marc. Le soir même il rouvre les yeux en pleine nuit. (Il faisait semblant de dormir. C’est lui maintenant qui joue la comédie.) Ayant appris à douter de lui-même ces derniers jours, il sent que quelque chose ne tourne pas rond dans cette histoire. Il doit se dire que cette Agnès qui dort auprès de lui n’est pas tout à fait réelle et qu’il est en plein dans son merdier. Ou que si c’est bien elle, rien ne changera vraiment et à leur retour sur Paris il n’y coupera pas : ce sera le retour dans l’enfer de la vie de couple, etc.
Voilà, maintenant que je vous ai bien ôté tout intérêt de voir le film en vous en racontant les moindres détails, il ne vous reste plus, comme moi, qu’à lire le livre dont s’inspire le film. Ma copine me dit qu’il se finit également en queue de poisson mais que la chute y est plus terrible encore. Gloups !
Published by Sylvain Fesson
-
dans
IDEEcryptage
4 octobre 2006
3
04
/10
/octobre
/2006
01:39

"Il n’y a pas de couple"
Je viens de voir La moustache, film d'Emmanuel Carrère sorti en 2004, et porté à l'écran par un joli duo d'acteur : Vincent Lindon (Marc) et Emmanuelle Devos (Agnès). Mais porté, le film l'est surtout par un livre : La moustache, roman du même Emmanuel Carrère (paru chez POL en 1986) et par ailleurs biographe de Philip K. Dick...
Ça n'a l'air de rien, mais pour Marc, cet acharnement qu’on lui fait subir à ne pas reconnaître qu'il a eu une moustache, ça lui colle une sévère déprime. Il en perd la tête. C’est à se demander ce que signifiait pour lui cette moustache et le fait de la raser. (Là est d’ailleurs La question du film. Là est la non-réponse sur laquelle repose tout le fil qui va se dérouler. Là est la "crime scene ", le mystère non élucidé. Il faut s’y faire : on ne saura jamais ce que cachait la moustache. On ne saura jamais quel cadavre elle avait dans le placard cette moustache qui tâche sans tâche. Elle ra réalisé le crime parfait. Et peu importe après tout qu’on sache : la vérité est ailleurs.) On ne peut que constater : il y a un avant et un après. Avant tout roulait, maintenant tout s’écroule.
Marc décroche. Nous aussi. Doucement malmené par ce scénario qui ne nous dit rien (ou peu) de ses intentions, on en perd notre latin cinématographique. Ce qui n’est pas fait pour nous déplaire. Au contraire. On se laisse porter et on cogite. Et perso, c’est comme ça que je l’aime le cinéma : quand il est un flux d’images et de formes énigmatiques me laissant le soin d’y voir ce que je veux. Et de mener l’enquête. Paraphrasons le Bashung de "L’irréel", qui funambule sur L’imprudence : "Le film écrit sa musique / Sur des portées disparues / Et l’orchestre (de nos crânes) aura beau faire pénitence (on n’y pigera que dalle)." Le film funambule comme lui.
Reprenons le fil de notre analyse : Marc pète les plombs avec sa moustache née sous X. Et à mesure que la folie le gagne, elle gagne aussi sa femme, Agnès, et les consume derechef dans une totale perte de repères. Agnès perd pied face à un mari qu’elle ne reconnaît plus en rien. Elle pensait avoir un homme solide sur lequel s’appuyer, un homme qu’elle pensait connaître, un homme qu’elle pensait aimer pour ce qu’elle savait être lui. Et voilà qu’elle se retrouve avec une loque, un inconnu, une épave qui à la tête de son mari, la voix de son mari, le corps de son mari, mais qui ne lui inspire plus aucun amour, qui ne lui envoie plus un seul des signaux de reconnaissance sur lesquels ils avaient passé accord. C’est violent pour elle ce que Marc lui fait subir. Pour un peu ce mari, elle le ramènerait au magasin pour le faire échanger. Car pour un peu, elle se sentirait tromper sur la marchandise. Quelque chose lui a donc initialement échappé à propos de Marc. Mais quoi ?
Elle lui conseille d'aller voir un psy. Elle ne le reconnaît pas parce qu’il se serait soi-disant rasé la moustache (puisque, pour elle, de moustache il n’y a jamais eu), elle ne le reconnaît pas dans ce soudain besoin qu’il a d’obtenir d’elle un regard différent sur lui, dans son besoin de se voir accepté par elle comme changé, redéfini (même si c’est infime, intime), elle ne le reconnaît pas dans ce besoin qu’il a d’être vu différemment, tel qu’il se voit, en soi, nu. Et dans son besoin d’obtenir un regard justificateur (presque maternel) d’elle, dans son besoin d’un tel regard impossible sur lequel il mise tout, n’étant plus qu’un trou noir, un homme qui s’atomise (étranger aux autres, étranger à lui-même), il l’entraîne dans sa chute. Bashung encore s’immisce, par "Est-ce aimer", L’imprudence toujours : "S’il suffisait / De se refaire une beauté / Pour retrouver grâce à tes yeux / S’il suffisait de se défaire / S’il suffisait de disparaître / Est-ce aimer / Est-ce aimer / S’il suffisait / D’abolir les écorchures / La peine qu’on se donne pour tenir / Une à une triomphent les ruines."
Inévitablement, le couple se délite. L’idée que l’un se faisait de l’autre (ce sur quoi le couple tenait, se liait, s’équilibrait, ce qui faisait le couple, le rendait possible), tout cela s’effondre, révélant la supercherie : impossible à connaître, impossible à fixer et prévoir une bonne fois pour toute, l’autre peut-il être aimé ? Et le couple survivre à une soudaine transparence des êtres ? Chaque geste du quotidien, les plus futiles, révèle alors de profonds désaccords, déchire un peu plus l’ex-couple modèle. Plus Agnès tente de sauver son couple, plus elle l’enfonce, accélère leur descente aux enfers à lui et elle, séparés à jamais. Exemple 1 : Elle emmène Marc faire les magasins pour lui offrir une veste et parvient à lui faire opter pour la veste qui lui à plait à elle (un truc immonde, bigarré vert feuille) sans se préoccuper du fait que lui ça ne l’emballe pas du tout. Exemple 2 : Ils sortent dîner dans un grand restaurant. Le menu en main, ils se rendent compte que les plats proposés ne leurs conviennent pas du tout. Lui émet sérieusement l’idée qu’ils s’en aillent sur le champ voir ailleurs. La voyant éclater de rire, il pense avoir son feu vert, il croit qu’elle acquiesce par là son côté sans gène, politiquement incorrect, sûr de lui. Mais elle lui balance froidement : "Tu n’y penses pas sérieusement ? Non, on va manger ici." Exemple 3 : De retour chez eux, il se dirige vers la chaîne hi-fi pour écouter un peu de musique classique avant de se coucher. Elle le rembarre illico : "Non, ce n’est pas l’heure, on va se coucher." Elle essaie de reprendre le contrôle sur lui, de le sculpter à sa mesure à elle. Mais rien n’y fait. Il s’éloigne d’elle. Il n’est plus là.
Sa petite comédie de l’amour rafistolé tombe tellement à l’eau que, devant le lien défait, Agnès jette d’elle-même l’éponge, avoue qu’il n’y a plus rien, qu’elle joue la comédie, qu’elle est perdue, qu’elle pédale dans une choucroute intersidérale, que tout est foutu. Elle fait l’aveu au restaurant. Mais par une culbute de génie, s’enfilant une clope et une coupe de champagne en un rien de temps (alors que ça fait trois ans qu’elle avait arrêté de fumer et qu’elle menait un vie très zen, axée thé, yoga et Feng Shui), elle relance par là même leur couple. En livrant du couple une toute nouvelle définition : "Ce n’est pas grave Marc ce qui nous arrive. Cette veste que je t’ai offerte, tu ne la mettras plus après ce soir, elle finira dans une armoire, mais ce n’est pas grave, c’est ce que font tous les couples, tu sais." Re-clope, re-coupe de champagne, les yeux aux bords des larmes.
Agnès tente de les ressouder en faisant appel à une vision désabusée, voire carrément nihiliste du couple. Un couple, lui dit-elle, c’est, drôle de paradoxe, la mésentente même. Un couple c’est la reconnaissance et l’acceptation d’une mésentente fondamentale, puisqu’on ne peut jamais connaître l’autre et l’aimer vraiment pour ce qu’il est (dans toute la profondeur et le vice de sa nature humaine). Alors unissons-nous contre cette tragédie que nous partageons on ne peut plus intensément mon chéri. Unissons-nous contre cette vérité tragique. Faisons de ce vide fatal qui nous sépare notre secret, notre combat et notre raison d’être en couple. Colmatons. Etouffons perpétuellement ce vide. Elle dit ça, mais elle n’y croit pas. C’est sa dernière carte qu’elle abat là. L’ultime supercherie. Il lui passe le briquet et s’en grille une à son tour.
Published by Sylvain Fesson
-
dans
IDEEcryptage
23 septembre 2006
6
23
/09
/septembre
/2006
03:07
 "Et si je me rasais... ?"
"Et si je me rasais... ?"
Je viens de voir La moustache, film d'Emmanuel Carrère sorti en 2004, et porté à l'écran par un joli duo d'acteur : Vincent Lindon (Marc) et Emmanuelle Devos (Agnès). Mais porté, le film l'est surtout par un livre : La moustache, roman du même Emmanuel Carrère (paru chez POL en 1986) et par ailleurs biographe de Philip K. Dick...
La moustache, avant de le voir, ça m'a rappelé les collègues de mon frère de l'agence d'infographisme Graphéine. Ils se sont lancés un défi stupide : se laisser pousser la moustache, uniquement la moustache, et récompenser celui qui tiendra le plus longtemps sans se la raser en lui offrant des BD. Pour l'instant, il n'y a pas de gagnants, ni de perdants. Ils ont l'air de s'y faire à leurs moustaches. Ils en seraient presque à s'enorgueillir de l'avoir parce que, parait-il, par une étrange culbute chic, porter la moustache n'est plus beauf mais... chic. Tendance. (Pas faux : Brandon Flowers, le chanteur du groupe de rock The Killers, a décidé de s'afficher portant la moustache dans le clip du single précédant la sortie de leur deuxième album, Sam's Town. Et en ce moment, Bob Dylan qui triomphe avec Modern Times, son 30e album, s'affiche toujours avec une fine moustache, qui lui donne des airs de Charlie Chaplin et de cow-boy spaghetti.) La moustache, avant de le voir, ça m'a également rappelé qu'un best of hommage à Freddy Mercury vient de sortir à l'occasion des 60 ans de sa naissance. Le génie de Queen portait impeccablement la moustache. Comme un tyran.
La moustache, après l'avoir vu, ça m'a laissé dans un drôle d'état d'inertie. Sans savoir trop quoi penser. Avec le loisir de pouvoir trop penser. En penser tout, et rien à la fois. Ma copine a lu le livre, moi pas. Je ne savais pas comment ça allait se finir. Queue de poisson oblige, je ne sais d'ailleurs toujours pas comment ça se finit, alors que je viens de le voir. Emmanuel Carrère est un petit malin. Il sait perdre son spectateur. Le laisser sans repère. C'est lui qui a écrit L'adversaire, en 1999 toujours chez POL et adapté trois ans plus tard sur grand écran par Nicole Garcia. Il a aussi écrit une biographie sur Philip K. Dick.
Première partie. "Tiens, et si je me rasais la moustache, ça te plairait ?" C'est la question en apparence banale que peut se poser tout homme qui se regarde le matin dans la glace, surtout s'il a cinq minutes devant lui pour passer à l'acte en se saisissant du rasoir et du tube de mousse. Se raser (la barbe, la moustache), c'est une des rares choses (socialement convenue) sur laquelle l'homme a prise pour modifier son apparence, se faire beau, et se faire autre, durant quelque temps. (Sur ce terrain, même si les hommes rattrapent leur retard, les femmes possèdent encore une plus grande marge de manœuvre.) "Tiens, et si je me rasais la moustache, ça te plairait ?" Une question qu'on se pose à soi, dans le miroir, mais qu'on peut aussi poser à l'autre, sa femme par exemple : autre miroir, plus déformant (quoique) que celui de la glace. Miroir dont on attend qu'il nous renvoie une réponse, un regard, une nouvelle image de nous-même, conforme à ce qu'on est dans le fond. "Tiens, et si je me rasais la moustache, ça te plairait ?" Ce matin, c'est la question que pose Marc à Agnès, sa femme, et tout par en couille. Elle ne remarque pas qu'il s'est rasé et pour cause : pour elle, il n'a jamais eu de moustache. Ça le ronge, Marc. Surtout qu'Agnès n'est pas la seule pour qui il n'a jamais eu de moustache. Ses collègues, le serveur du café d'en face, les amis de sa femme, tous sont formels : il n'a jamais eu de moustache. Rien. Nada.
Published by Sylvain Fesson
-
dans
IDEEcryptage
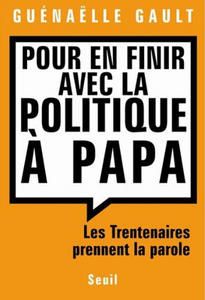

 A ce propos, tu parles d’Internet, du fait que les trentenaires ont une intense vie sociale en se connectant sans cesse à différents réseaux. Mais avoir son Myspace ou consulter le Myspace de quelqu’un n’est-ce pas s’insérer dans un rapport instrumentalisé à l’autre, qu’on peut zapper à l’envie ?
A ce propos, tu parles d’Internet, du fait que les trentenaires ont une intense vie sociale en se connectant sans cesse à différents réseaux. Mais avoir son Myspace ou consulter le Myspace de quelqu’un n’est-ce pas s’insérer dans un rapport instrumentalisé à l’autre, qu’on peut zapper à l’envie ? Sur un autre plan, cela me rappelle l’émission de TF1, J’ai question à vous poser. J’ai vu le comportement du panel de Français présent quand Ségolène Royal y était invitée et on aurait dit des enfants. Chacun y allait de sa plainte, de son petit problème personnel…
Sur un autre plan, cela me rappelle l’émission de TF1, J’ai question à vous poser. J’ai vu le comportement du panel de Français présent quand Ségolène Royal y était invitée et on aurait dit des enfants. Chacun y allait de sa plainte, de son petit problème personnel…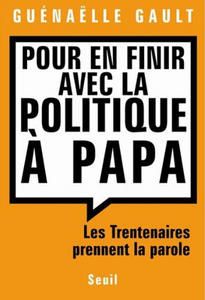

 A ce propos, tu parles d’Internet, du fait que les trentenaires ont une intense vie sociale en se connectant sans cesse à différents réseaux. Mais avoir son Myspace ou consulter le Myspace de quelqu’un n’est-ce pas s’insérer dans un rapport instrumentalisé à l’autre, qu’on peut zapper à l’envie ?
A ce propos, tu parles d’Internet, du fait que les trentenaires ont une intense vie sociale en se connectant sans cesse à différents réseaux. Mais avoir son Myspace ou consulter le Myspace de quelqu’un n’est-ce pas s’insérer dans un rapport instrumentalisé à l’autre, qu’on peut zapper à l’envie ? Sur un autre plan, cela me rappelle l’émission de TF1, J’ai question à vous poser. J’ai vu le comportement du panel de Français présent quand Ségolène Royal y était invitée et on aurait dit des enfants. Chacun y allait de sa plainte, de son petit problème personnel…
Sur un autre plan, cela me rappelle l’émission de TF1, J’ai question à vous poser. J’ai vu le comportement du panel de Français présent quand Ségolène Royal y était invitée et on aurait dit des enfants. Chacun y allait de sa plainte, de son petit problème personnel…


 Depuis le 21 avril 2002 les trentenaires entretiennent avec la démocratie une relation pleine de désillusions. Alors quand ils entendent que les présidentielles de 2007 témoignent d’un regain de démocratie au vu des 86% de participation, leurs dents grincent. La politique n’a pas changé et ce n'est pas le niveau d'abstention aux dernières législatives qui viendra prouver le contraire.
Depuis le 21 avril 2002 les trentenaires entretiennent avec la démocratie une relation pleine de désillusions. Alors quand ils entendent que les présidentielles de 2007 témoignent d’un regain de démocratie au vu des 86% de participation, leurs dents grincent. La politique n’a pas changé et ce n'est pas le niveau d'abstention aux dernières législatives qui viendra prouver le contraire. 
 "marrante"
"marrante"  Tu veux dire qu’on est dans un spectacle de la parole ?
Tu veux dire qu’on est dans un spectacle de la parole ?