en chanteuse

Je viens de parler de Vincent Lindon via le film La moustache. Je vais maintenant parler de son ex-femme, Sandrine Kiberlain. Mais pas l'actrice, la chanteuse. Car chanteuse elle l'est depuis la sortie de Manquait plus que ça, son premier disque en mai 2005.
Je vous en reparle malgré le temps écoulé (l'interview remonte à l'été 2005) car je suis actuellement en train de préparer un long article sur les actrices-chanteuses, grâce auquel j'ai aussi interviewé depuis Jeanne Balibar et Cholé Mons. Mais Sandrine était la première. Et le moment fut exquis, juste ce qu'il faut. Et l'interview intéressante, toujours sur ce mode de la discussion que j'affectionne et qui a tendance à devenir mon unique manière de mener les interviews.
Je stressais un peu avant la rencontre. Je stresse toujours avant une interview d'artiste. L'impression de redevenir élève. La boule au bide d'avant l'exam. Totalement imprégné, vampirisé par la feuille de route que je me suis préparé. Concentré pour mener à bien mon scénario, construit sur le feeling me reliant et forant à travers l'univers et la psychée de l'artiste. J'ai des questions osées. Je mise beaucoup. Je veux qu'il en ressorte quelque chose de… spécial, de… durable de cette interview.
Je stresse toujours avant une interview d'artiste. Mais plus encore quand il s'agit d'une actrice que d'une chanteuse. Une actrice, j'ai l'impression, ce n'est pas comme une chanteuse. Pas comme les chanteuses que je rencontre d'habitude. J'ai toujours l'impression qu'il va falloir prendre des gants avec une actrice, que ça va être plus pincé une actrice, moins nature, moins franc du collier. Comme si l'actrice restait tout le temps actrice. Qu'elle était moins souvent la femme sous l'actrice. Qu'elle était moins la femme sous l'actrice que la chanteuse est la femme sous la chanteuse.
Une actrice, j'ai toujours l'impression que ça se lâche moins. Ça représente autre chose, c'est plus superficiel, il y a trop de tuyaux autour d'elle, une actrice. L'impression que si elle lâche, ça pète. Car elle est l'otage d'une industrie plus lourde, le fruit d'une popularité plus grande, conditionné par le poids de l'image, prise au centre d'un film qui finalement lui échappe de trop, qui ne se réduit pas à elle.
Mais j'ai eu la chance de rencontrer Sandrine Kiberlain la chanteuse et tout s'est bien passé. Limite j'aurais rencontré Sandrine Kiberlain l'actrice, et ç'aurait été tout comme, juste, charmant, léger, dans le cadre idylliquement zen d'un bar/resto boisé chic.
Je voulais en profiter pour lui poser une question au sujet d’un monologue qu’elle tient dans le film Rien sur Robert, devant un Fabrice Lucchini subitement médusé, sans voix. Un comble connaissant l'hystérie verbale du bonhomme. A vrai dire, les quelques jours qui ont précédé la rencontre, cette scène m'a presque obsédée. Parce que dans sa bouche, elle fait tâche. Cette tirade qui cause cul crûment, qui déboule sans prévenir et vide son sac froidement, elle contraste tellement avec ce qu’est Sandrine, c'est-à-dire une femme et une actrice au physique et au caractère lunaire, maladroit, effacé, qu’on obtient un moment culte. Qui souffle sa grâce comme un boulet de canon.
Oui, les quelques jours qui ont précédé la rencontre, c’est limite si je ne fantasmais pas sur Sandrine en partant de cette scène. Un comble. Elle n’est pas canon Sandrine. Elle a un physique un peu trop bancal, décalé. Mais décalé juste ce qu’il faut, je dirais. Elle le sait. Et elle en parle d’ailleurs très bien elle-même dans le single de son premier album d’actrice devenue chanteuse. Une vraie. Parce qu’elle écrit aussi ses propres textes. Parce qu’elle a des choses à dire et qu’elle les dit joliment, justement, parfois durement sous couvert d'épure, de simplicité, dans un français limpide, impossible à esquiver.
Charlotte Gainsbourg aurait dû prendre un peu exemple la démarche super sincère Sandrine. Ça ne l'aurait pas fait accoucher d'un album anglophile, chic et vaporeux à mourir. Le disque de Sandrine Kiberlain n'est pas un sommet ni même un must-have, mais un rien décalé comme son auteure et lui ressemblant traits pour traits on se surprend à l'écouter avec plaisir cette petite soeur cachée d'Alain Souchon.
(Suite.)







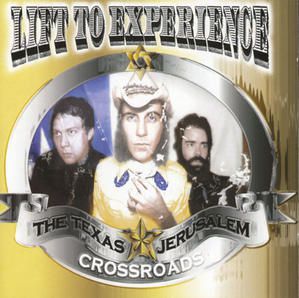 "Hell is other people"
"Hell is other people" 
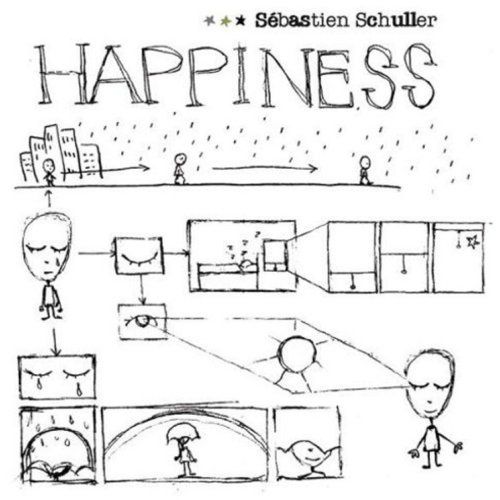

 Ah ! les bonbons Krema, les odeurs d'encens, c'est ça aussi O'CD. C'est ça qui, en plus de la pléiade de disques, fait qu'on s'y sent comme chez soi. Comme on se sent chez soi chez un Starbucks. D'ailleurs, une machine à café est disponible, on peut s'y faire un kawa, histoire de rester aware, pour l'épique session d'écoute. Mais on ne découvre pas que des disques chez O'CD. Il arrive qu'on y découvre aussi des OB'CD, un peu comme soi…
Ah ! les bonbons Krema, les odeurs d'encens, c'est ça aussi O'CD. C'est ça qui, en plus de la pléiade de disques, fait qu'on s'y sent comme chez soi. Comme on se sent chez soi chez un Starbucks. D'ailleurs, une machine à café est disponible, on peut s'y faire un kawa, histoire de rester aware, pour l'épique session d'écoute. Mais on ne découvre pas que des disques chez O'CD. Il arrive qu'on y découvre aussi des OB'CD, un peu comme soi… Son regard sur moi était important, parce que c'était dit comme ça, de l'étranger, du dehors. On ne se connaissait pas. C'était dit comme ça, d'un étranger à un autre, de manière... pas objective justement, mais plutôt insidieusement subjective. Comme une sorte de feeling, de pressentiment, de plongée de lui en moi. Comme si le monde m'avait parlé à travers lui. Ça fait con, dit comme ça. Mais ça fait du bien de se sentir décoder, deviner dans les yeux d'un autre. Comme si le monde envoyait un signe. A certaines périodes, on a particulièrement besoin de ça. Ça sauve un peu. Ça m'est arrivé deux fois dans ma vie de recevoir un tel geste, où l'on me disait fait pour la critique musicale. Un jour, une amie m'a écrit une lettre et elle m'a dit tout de go :
Son regard sur moi était important, parce que c'était dit comme ça, de l'étranger, du dehors. On ne se connaissait pas. C'était dit comme ça, d'un étranger à un autre, de manière... pas objective justement, mais plutôt insidieusement subjective. Comme une sorte de feeling, de pressentiment, de plongée de lui en moi. Comme si le monde m'avait parlé à travers lui. Ça fait con, dit comme ça. Mais ça fait du bien de se sentir décoder, deviner dans les yeux d'un autre. Comme si le monde envoyait un signe. A certaines périodes, on a particulièrement besoin de ça. Ça sauve un peu. Ça m'est arrivé deux fois dans ma vie de recevoir un tel geste, où l'on me disait fait pour la critique musicale. Un jour, une amie m'a écrit une lettre et elle m'a dit tout de go :  J'ai recroisé Franck quelques années plus tard, par hasard. Il m'a appris qu'il s'était découvert chanteur ; qu'il s'était découvert une vraie voix et qu'il prenait des cours, pour travailler ces trésors lyriques dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. C'était chouette d'apprendre ça. Comme de savoir qu'on a peut-être tous en nous un puit de pétrole. Quelque chose comme ça. Mais qu'il faut creuser pour l'atteindre, que ça n'arrive pas comme ça. Moi, j'étais en stage à Rollingstone magazine. J'ai recroisé Franck quelques années plus tard encore, par hasard. Son nom (Franck Nasca : parolier) sur la pochette d'un album :
J'ai recroisé Franck quelques années plus tard, par hasard. Il m'a appris qu'il s'était découvert chanteur ; qu'il s'était découvert une vraie voix et qu'il prenait des cours, pour travailler ces trésors lyriques dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. C'était chouette d'apprendre ça. Comme de savoir qu'on a peut-être tous en nous un puit de pétrole. Quelque chose comme ça. Mais qu'il faut creuser pour l'atteindre, que ça n'arrive pas comme ça. Moi, j'étais en stage à Rollingstone magazine. J'ai recroisé Franck quelques années plus tard encore, par hasard. Son nom (Franck Nasca : parolier) sur la pochette d'un album : 
 Chez O'CD, on rattrape le temps perdu. On met enfin une musique sur la tonne de groupes dont la presse n'a pas arrêté de nous vanter les mérites. On écoute et d'un coup l'écoute déforeste tous leurs articles et toutes leurs phrases, aussi belles et justes soient elles. On se fait un avis, même éclair, sur la production discographique des derniers mois. On écoute même des CD's que, trop jeunes, on n'a pas découvert en leurs temps. Pour découvrir qu'en vérité, ils sont merdiques. Qu'en toute sincérité, on préfère le dernier groupe en The, le truc hyper mélodique qui va tourner en boucle sur notre platine, au truc certes novateur, mais emmerdant, qui peine à révéler son ramage. Heureusement, l'inverse est tout aussi vrai. Ici se trouve le purgatoire des CD's en attente de rachat. Ici se trouve tout ce que les iPod ont recraché après transfert de data. Le règne de la musique concrète, payante. De la musique qui a un poids et un prix (honnête le prix, 5, 7, 9, 11, voire 13 euros le CD, c'est honnête). Ça fait réac de dire ça. Mais ça fait du bien de fouiner comme ça dans ces bacs à CD's. D'y nager un peu, comme Picsou dans son or. Et de se sentir riche à l'idée de trouver le CD adoré. O'CD, c'est aussi le règne de la subjectivité en matière de musique. Je suis toujours un peu étonné de trouver des merveilles dans ces CD's jetés au rebut par des particuliers. A voir la gueule de certains, mais pour d'autres, cela reste un mystère. Que font là les albums de Peter Von Poehl (
Chez O'CD, on rattrape le temps perdu. On met enfin une musique sur la tonne de groupes dont la presse n'a pas arrêté de nous vanter les mérites. On écoute et d'un coup l'écoute déforeste tous leurs articles et toutes leurs phrases, aussi belles et justes soient elles. On se fait un avis, même éclair, sur la production discographique des derniers mois. On écoute même des CD's que, trop jeunes, on n'a pas découvert en leurs temps. Pour découvrir qu'en vérité, ils sont merdiques. Qu'en toute sincérité, on préfère le dernier groupe en The, le truc hyper mélodique qui va tourner en boucle sur notre platine, au truc certes novateur, mais emmerdant, qui peine à révéler son ramage. Heureusement, l'inverse est tout aussi vrai. Ici se trouve le purgatoire des CD's en attente de rachat. Ici se trouve tout ce que les iPod ont recraché après transfert de data. Le règne de la musique concrète, payante. De la musique qui a un poids et un prix (honnête le prix, 5, 7, 9, 11, voire 13 euros le CD, c'est honnête). Ça fait réac de dire ça. Mais ça fait du bien de fouiner comme ça dans ces bacs à CD's. D'y nager un peu, comme Picsou dans son or. Et de se sentir riche à l'idée de trouver le CD adoré. O'CD, c'est aussi le règne de la subjectivité en matière de musique. Je suis toujours un peu étonné de trouver des merveilles dans ces CD's jetés au rebut par des particuliers. A voir la gueule de certains, mais pour d'autres, cela reste un mystère. Que font là les albums de Peter Von Poehl ( Quelque part, tant mieux. Car quel bonheur de trouver un album qu'on adore avec au dos, nu, la pastille jaune indiquant qu'il n'est qu'à 7 euros. L'impression de toucher le gros lot. Récemment, ils ont même crée une pastille orange, pour les CD's 5 euros. Pour une bouchée de pain, j'ai donc acheté "en vrai" des albums que j'avais "en gravé" et que j'aimais finalement trop pour ne pas les avoir avec la pochette et tout ; officialisant et renforçant ainsi la nature de ma relation avec eux ; ce qui fait un grand bien. J'ai fait de superbes acquisitions ici, troquant de purs chefs d'oeuvres contre d'affreuses daubes... qui ont sûrement plu à d'autres. Chez O'CD ma discothèque s'est refaite une beauté. Une santé. Moi de même. J'ai rêvé à O'CD, au point d'y écrire parfois, et de partir comblé, avec un article quasi-fini sous le bras, en plus de ma savoureuse collation de CD's empaquetée dans son enveloppe de papier kraft. Oui, j'en ai chroniqué quelques disques là-bas, prenant des notes sur place, comme un enfant sauvage, déraciné, les oreilles perdues dans le casque, la tête pleine d'idées et d'images, me documentant comme si j'étais à la BPI. Plage après plage. Car O'CD en fait, c'est un peu comme... une médiathèque en payant. En payant mais pas cher. O'CD, c'est un peu comme... une Fnac, mais honnête. Une Fnac qui en serait restée à la musique et qui pratiquerait une politique de prix sans foutage de gueule où tous les disques seraient continuellement en promo ou au prix vert ; ce qui est le prix normal que devrait coûter un CD. A titre d'information, apprend-t-on sur leur site, que chez O'CD
Quelque part, tant mieux. Car quel bonheur de trouver un album qu'on adore avec au dos, nu, la pastille jaune indiquant qu'il n'est qu'à 7 euros. L'impression de toucher le gros lot. Récemment, ils ont même crée une pastille orange, pour les CD's 5 euros. Pour une bouchée de pain, j'ai donc acheté "en vrai" des albums que j'avais "en gravé" et que j'aimais finalement trop pour ne pas les avoir avec la pochette et tout ; officialisant et renforçant ainsi la nature de ma relation avec eux ; ce qui fait un grand bien. J'ai fait de superbes acquisitions ici, troquant de purs chefs d'oeuvres contre d'affreuses daubes... qui ont sûrement plu à d'autres. Chez O'CD ma discothèque s'est refaite une beauté. Une santé. Moi de même. J'ai rêvé à O'CD, au point d'y écrire parfois, et de partir comblé, avec un article quasi-fini sous le bras, en plus de ma savoureuse collation de CD's empaquetée dans son enveloppe de papier kraft. Oui, j'en ai chroniqué quelques disques là-bas, prenant des notes sur place, comme un enfant sauvage, déraciné, les oreilles perdues dans le casque, la tête pleine d'idées et d'images, me documentant comme si j'étais à la BPI. Plage après plage. Car O'CD en fait, c'est un peu comme... une médiathèque en payant. En payant mais pas cher. O'CD, c'est un peu comme... une Fnac, mais honnête. Une Fnac qui en serait restée à la musique et qui pratiquerait une politique de prix sans foutage de gueule où tous les disques seraient continuellement en promo ou au prix vert ; ce qui est le prix normal que devrait coûter un CD. A titre d'information, apprend-t-on sur leur site, que chez O'CD  A "contre-courant de l'information compactée qui constitue la tendance générale", GA prend donc le temps, de développer les sujet, de prendre du recul. En gros, il fait long. Mais il sait s’étendre sans se répandre. D’où des articles "revues" dans le sens de la longueur – grands par la taille et l’exigence éditoriale – mais qui ne se perdent pas dans le charabia universitaire, où je ne sais quels autres travers. Des articles exigeants, pas excluants. Ce que confirme le sommaire du n°4, de juillet-août-septembre. Entre le sauvetage de la Banque Mondiale, l'influence politique des Guignols de l'info, Dieu et la philosophie, l'Islam, l'Occident et le Mecca Cola, et les leçons de l'Inde en matière de multiculturalisme, il y a de quoi lire, s'enrichir, s’intéresser, réfléchir.
A "contre-courant de l'information compactée qui constitue la tendance générale", GA prend donc le temps, de développer les sujet, de prendre du recul. En gros, il fait long. Mais il sait s’étendre sans se répandre. D’où des articles "revues" dans le sens de la longueur – grands par la taille et l’exigence éditoriale – mais qui ne se perdent pas dans le charabia universitaire, où je ne sais quels autres travers. Des articles exigeants, pas excluants. Ce que confirme le sommaire du n°4, de juillet-août-septembre. Entre le sauvetage de la Banque Mondiale, l'influence politique des Guignols de l'info, Dieu et la philosophie, l'Islam, l'Occident et le Mecca Cola, et les leçons de l'Inde en matière de multiculturalisme, il y a de quoi lire, s'enrichir, s’intéresser, réfléchir.  Eric Rohde, qu’est-ce que GA ?
Eric Rohde, qu’est-ce que GA ?